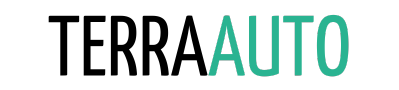Le classique panneau STOP devient bleu : mythe ou réalité ?
En Europe et dans la majorité des pays signataires de la Convention de Vienne, le panneau STOP est immuable : un octogone rouge barré de son lettrage blanc. Pourtant, aux États-Unis, on trouve une version au fond bleu. Loin d’être un simple gadget esthétique, ce choix de couleur répond à des raisons juridiques et pratiques, principalement sur les terrains privés. Où et pourquoi rencontre-t-on ces panneaux atypiques ? Éclairages.
Origine et normalisation du panneau octogonal
Dans les années 1920, les autorités américaines expérimentèrent plusieurs formes et couleurs pour indiquer l’obligation de marquer l’arrêt :
- Formes variées : rectangle, losange, cercle, jusqu’à l’octogone, retenu pour sa silhouette unique et facilement reconnaissable.
- Couleurs initiales : jaune réfléchissant afin d’assurer une visibilité maximale de nuit ou par mauvais temps.
Avec l’avènement des matériaux rétroréfléchissants, le rouge devint la norme aux États-Unis en 1954. La Convention de Vienne de 1968 imposa ensuite l’octogone rouge comme panneau international standard (signalisation n° STOP). En France, il est codifié sous le numéro 206 de la signalisation routière, signifiant « arrêt absolu » et « priorité à droite ».
Pourquoi un fond bleu ? Le cas particulier d’Hawaï
Sur le territoire continental américain, les panneaux STOP restent rouges sur la voie publique. En revanche, à Hawaï, très grande partie des voiries est en propriété privée :
- Zones résidentielles, lotissements et resorts, gérés par des associations ou des bailleurs.
- Le code de la route local interdit d’installer un panneau réglementaire rouge sur un terrain privé.
Pour contourner cette contrainte, les propriétaires adoptèrent un modèle identique en forme (octogone) et en lettrage (« STOP »), mais avec un fond bleu. Ainsi, la signalisation demeure visuellement consistante, tout en respectant la législation qui réserve le panneau rouge aux voies publiques.
Au-delà d’Hawaï : d’autres États et terrains privés
Si l’archipel hawaïen est le meilleur exemple de panneaux bleus, on en rencontre également :
- Dans certaines copropriétés et gated communities en Californie, Texas, Floride…
- Aux abords de centres commerciaux privés, de campus universitaires et de zones d’activités industrielles.
- Sur des chemins d’accès à des propriétés viticoles ou touristiques, où la signalétique privée domine.
Sur ces voies, le conducteur doit traiter le panneau bleu comme un STOP classique : s’arrêter, laisser passer les véhicules prioritaires, puis redémarrer lorsque la voie est libre. Le fond bleu sert uniquement à distinguer le domaine privé du domaine public.
Même signification, mêmes obligations
Conduire face à un panneau STOP bleu implique les mêmes règles que sur un rouge :
- Arrêt complet avant la ligne blanche ou la limite de visibilité si la ligne manque.
- Priorité à droite pour tout véhicule arrivant simultanément.
- Infraction passible d’une amende et, en cas de récidive ou de mise en danger, d’une suspension de permis.
Le Code de la route français n’a pas prévu de version bleue : hors d’Europe, il convient de respecter la signalisation locale, d’autant plus sur un terrain privé où le gestionnaire peut décliner sa propre charte graphique.
L’avenir de la signalisation privée
À l’heure où la mobilité évolue (véhicules autonomes, gestion connectée des flux), la frontière entre public et privé se précise :
- Les gestionnaires de parking privés expérimentent des panneaux dynamiques pour adapter la circulation.
- Les systèmes de guidage audiovidéo informent en temps réel de la réglementation spécifique à un domaine.
- En Europe, la réflexion sur la signalisation intelligente pourrait, demain, intégrer des balises lumineuses adaptatives, sans toucher à la couleur traditionnelle du STOP public.
En attendant, si vous parcourez Hawaï pour un road trip ou empruntez une voie privée aux États-Unis, ne soyez pas surpris de croiser un panneau STOP bleu : c’est le même message, caché sous un nouveau teint.