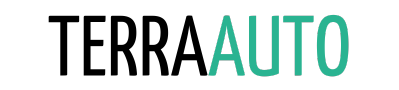EnBW mobility+, filiale du groupe Energie Baden-Württemberg spécialisée dans la mobilité électrique, a déclenché une petite onde de choc dans le débat public. Pour Fabian Kneule, son directeur financier, le gouvernement ferait mieux de revoir son mode de soutien à l’électromobilité plutôt que d’apporter une aide directe au déploiement des infrastructures de recharge.
Contexte énergétique et défi du prix de l’électricité
Depuis 2022, la flambée des prix de l’électricité pèse lourdement sur les coûts d’exploitation des bornes de recharge. En tant qu’acteur majeur de la recharge rapide et lente en Allemagne, EnBW mobility+ subit de plein fouet cette hausse. Les abonnements aux offres de recharge, qui incluent une part de tarif indexé sur le marché spot, sont devenus plus onéreux pour l’automobiliste électrique.
La question est donc celle de la stabilité tarifaire : comment garantir un prix de l’électricité prévisible pour les usagers tout en préservant la rentabilité des opérateurs ? Pour Kneule, un soutien ciblé aux tarifs de recharge – via des réductions, des plafonds ou un bouclier tarifaire – serait plus efficace qu’un simple financement de nouvelles lignes haute tension.
Pourquoi EnBW mobility+ refuse les subventions pour le réseau
Le CFO expose plusieurs raisons pour rejeter les aides publiques au déploiement du réseau :
- Effet d’aubaine : les opérateurs risquent de dépendre de subventions sans chercher à optimiser leurs coûts internes ;
- Complexité administrative : l’allocation et le suivi des fonds publics pour les infrastructures techniques peuvent retarder les projets ;
- Priorité à la demande : soutenir directement le consommateur final accroît l’adoption des véhicules électriques, générant naturellement le besoin d’infrastructures accrues ;
- Flexibilité technologique : un opérateur qui investit seul dans le réseau reste libre de choisir la technologie la plus adaptée (AC versus DC, localisation, module logiciel) sans contrainte de cahier des charges public.
Renaissance de la prime à l’achat et subvention du kWh de recharge
À ses yeux, la prochaine étape pour accélérer la transition électrique consiste à :
- Relancer une prime à l’achat : une aide financière directe pour l’acquisition de véhicules électriques neufs ou d’occasion, ajustée selon le revenu des ménages ;
- Subventionner le prix du kWh : appliquer une remise (par exemple 0,10 à 0,20 €) sur chaque kilowattheure facturé aux bornes publiques ;
- Forfait de recharge illimitée : offrir des forfaits mensuels garantissant un tarif plafonné, afin de rassurer l’utilisateur sur ses dépenses de mobilité ;
- Incitations fiscales : crédit d’impôt ou déduction des frais de recharge pour les travailleurs en télétravail ou les flottes d’entreprise.
Selon Kneule, ces dispositifs permettraient de rendre l’usage de la voiture électrique plus attractif et compétitif, sans pour autant grever un budget public destiné à l’aménagement du réseau électrique.
Un coup de pouce pour les contrôles et la santé de la batterie
Enfin, Fabian Kneule plaide pour l’instauration d’un « chèque batterie » subventionné lors des contrôles d’usure :
- Diagnostic officiel : prise en charge partielle du coût d’un test de capacité et de résistance de la batterie (50 à 100 €) ;
- Certificat d’état : délivrance d’un document standardisé attestant de l’autonomie restante, renforçant la transparence lors de la revente d’un véhicule électrique d’occasion ;
- Sécurité accrue : détection précoce des cellules endommagées pour prévenir tout risque thermique ou de panne en cours d’utilisation ;
- Valorisation du véhicule : un véhicule disposant d’un chèque batterie récent bénéficiera d’une cote plus élevée sur le marché de l’occasion.
Ce type d’aide, estime-t-il, renforcerait la confiance des conducteurs potentiels et résoudrait l’une des principales réticences à l’achat : la crainte d’une dégradation rapide du pack batterie.
Vers un modèle de soutien ciblé pour l’électromobilité
En résumé, EnBW mobility+ propose de rediriger les fonds publics vers l’utilisateur et le renforcement de la confiance plutôt que vers l’expansion du réseau, déjà largement financée par les acteurs privés et européens.
La logique est claire : un marché des véhicules électriques florissant créera naturellement une demande accrue en infrastructures de recharge, encourageant ensuite les investissements privés dans de nouveaux points de charge. À l’inverse, subventionner en premier lieu le réseau risquerait de laisser les conducteurs sans solution abordable au moment de la recharge.
La balle est désormais dans le camp des responsables politiques, qui doivent arbitrer entre deux visions : une aide directe au consommateur pour stimuler la demande ou un soutien au réseau pour garantir l’offre. Le choix façonnant l’avenir de la mobilité électrique en Europe se fera probablement avant la fin de l’année.